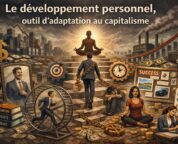« Aujourd’hui, notre tâche la plus urgente est peut-être d’apprendre à penser autrement » Gregory Bateson (1972, 1980)1
« Le réel n’est jamais « ce qu’on pourrait croire » mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser. » Gaston Bachelard (1938)2
« Il nous faut inventer de nouveaux raisonnement, et en attendant, si nous devons être de quelque utilité, passer pour dangereux, intempestifs, peu orthodoxes, infidèles même à ceux qui nous ont précédés » John Maynard Keynes (1933)2bis
Résumé
Selon l’expert-comptable Jacques Richard, la comptabilité n’est pas fidèle à la réalité. Pour le juriste, que je suis, la comptabilité est une copie d’actes et faits qualifiés par les juristes et les économistes du courant dominant. Dès lors, pour rendre la comptabilité fidèle à la réalité, ces derniers devraient revoir leurs concepts.
Conversation
Je disais à Jacques Richard, auteur avec Alexandre Rambaud du livre Révolution comptable : « Vous avez une vision fidèle de la réalité, comme la comptabilité doit l’être ».
Pour moi, la comptabilité est une copie d’actes et faits juridico-économiques, c’est-à-dire d’actes et faits appréhendés (conceptualisés) d’abord par le droit et l’économie3.
« L’identification juridique des biens constitue une dimension première de l’expérience occidentale. […] Le droit construit la première strate conceptuelle sans laquelle il est impossible de penser quoi que ce soit qui s’apparente à l’économie. Les biens qui entrent dans les échanges ne sont jamais simplement prélevés sur la nature. Ils sont d’abord socialisés par une qualification juridique, pourvus de possesseurs légitimes, avant de pouvoir faire l’objet d’échanges, sous la forme de contrats. Il n’y a d’économie concevable que dans un monde déjà balisé par le droit. » (Sylvain Piron, (2018), L’occupation du monde, Zones Sensibles, p. 160)
« Le produit ne serait pas mesurable s’il n’était porté par la monnaie. La monnaie de crédit est elle-même mesurée en unités purement arithmétiques. La loi permettant de prêter la mesure arithmétique de la monnaie aux biens et aux services réels est l’équivalence économique entre le travail et son produit. 1) Le travail est mesuré arithmétiquement dans sa rémunération monétaire. 2) Le travail étant équivalent à son produit, la somme des rémunérations monétaires mesure le produit national en biens et en services réels. 3) La mesure arithmétique du produit est la définition scientifique de la « valeur économique » : elle est une mesure-dénombrement et non une mesure dimensionnelle. » (Bernard Schmitt, (1977), L’Or, le dollar et la monnaie supranationale, Calman Levy, p. 58)
Jacques Richard m’a répondu que la fidélité était absente en comptabilité.
Sans doute, la copie comptable actuelle n’est pas conforme à la réalité ou, plus exactement, elle traduit la réalité, mais, conformément aux analyses juridico-économiques4 en vigueur. Alors, n’est-ce pas plutôt la vision de la réalité des juristes et des économistes du courant dominant qui n’est pas conforme à la réalité ? Deux exemples suivent.
« Instituer un marché du travail supposait en effet de faire du travail l’objet possible du contrat. Ce contrat a été conçu sur le modèle du louage. Mais il ne pouvait s’agir d’un louage ordinaire, car le preneur à bail [l’employeur] ne peut ici entrer en possession de la chose louée : ‘par exception à ce qui semble de la nature du louage, il n’y a pas de remise matérielle à l’employeur de la force de travail, faute de pouvoir détacher celle-ci du corps du salarié’. L’assujettissement du salarié à la volonté de l’employeur vient compenser l’impossibilité pour ce dernier de rentrer directement en possession de la force de travail dont il a conventionnellement acquis la jouissance. ‘La subordination apparaît alors comme un substitut de la dépossession’. Ainsi s’est trouvé lié, dans le contrat de travail, le travail en tant que bien détachable du travailleur, et la subordination en tant que forme particulière d’entrée en possession de ce bien. » (Alain Supiot, (2000), « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, n° 2, p. 132).
S’agit-il du marché de la force de travail ? Le travail est une action et non une marchandise5 et sa rémunération en monnaie est la formation d’un revenu monétaire donnant droit au produit du travail et non le paiement du prix de vente d’une marchandise6.
« Les économistes ont parfois recherché la solution d’un faux problème : combien de catégories de « facteurs de production » faut-il distinguer ? Le terme n’est pas clair, car il désigne tout élément qui concourt à un résultat. Il est évident que la production nationale suppose la réunion d’un grand nombre de facteurs disparates. Toutefois, certaines écoles simplifient les données pour grouper les facteurs de production en deux ou en trois catégories principales : la terre, le capital, le travail. Cette classification est soit trop large, soit trop limitative. Si le terme de facteur est pris en son acception habituelle, les trois catégories ne comprennent qu’une partie de la réalité, car il conviendrait d’ajouter de nombreux autres facteurs, comme l’organisation politique et idéologique de la société, la psychologie des groupes sociaux, la technologie, l’éducation, l’esprit de création scientifique, la faculté d’innover, etc. En revanche, si par ‘facteur de production’ l’on entend la source des produits quantifiables, leur ’cause’, seul le travail humain peut être retenu, tel qu’il est défini dans tout son environnement naturel, social et économique, la terre et le capital étant les principales ‘conditions’ du travail, qui est seul créateur.
La logique distingue deux degrés.
1er degré. La terre et le capital sont, parmi d’autres facteurs, la condition nécessaire du travail humain.
2e degré. Le travail humain est la condition nécessaire et suffisante du produit.
Il en découle que la terre et le capital sont, avec d’autres facteurs, la condition nécessaire du produit ; mais cette condition nécessaire est déjà comptée au niveau du travail, c’est-à-dire au premier degré. Dans l’opération du deuxième degré – la production au sens strict – le travail humain reste donc, à lui seul, la condition nécessaire et suffisante du produit. » (Bernard Schmitt, (1977), op. cit., p. 36 et 37).
Pourquoi avons-nous oublié la nature (1er degré) et pourquoi avons-nous oublié que l’existence du travail rémunéré (2e degré) dépend de la nature ? L’historien médiéviste Sylvain Piron enrichit et étaye dans deux livres7 la réponse de son collègue américain Lynn Whyte et celle, plus complète, de l’anthropologue d’origine anglaise Gregory Bateson8 : « Le rapport d’extériorité au monde que produit le christianisme ne pousse pas seulement à connaître et à transformer l’environnement. Il implique aussi d’en prendre possession pour l’exploiter »9. Mais, le contrôle des esprits n’est-il pas « la tâche du pouvoir religieux, intimement lié au temporel, quand il n’est pas confondu avec lui. Il est présent partout, à toutes les époques, sous toutes les formes. […] Sa fonction est de faire accepter et légitimer la soumission à l’ordre établi »8bis. En Amérique, la « libération » de « l’état de nature », fondée sur la propriété de la terre et des esclaves noirs et qui s’est actualisée comme institution d’un « espace-système de la liberté », y est sans doute pour quelque chose10. Pour le philosophe Baptiste Morizot, en inventant le concept de production, c’est-à-dire « l’idée qu’on va imposer depuis notre intentionnalité et notre intelligence une forme à une matière qui est passive et abstraite », « l’homme se libère de toute exigence de réciprocité avec le milieu »11
La réponse est affirmative et, ce qui est remarquable, c’est que la critique de la fidélité de la copie vient du comptable.
Je confirme, Jacques Richard a une vision fidèle (à la réalité) et il est nécessaire que les juristes et les économistes revoient leurs concepts qui, eux, manquent de fidélité (à la réalité) ! Ainsi, la comptabilité deviendra fidèle (à la réalité).
Pour aider à l’action nécessaire des juristes et des économistes, je complète les deux exemples précités comme suit.
« Ce qui manque aujourd’hui, c’est une perspective économique sui generis permettant de faire de l’économie une science fondée sur ses propres structures et lois logiques. […] L’économie n’est pas seulement l’étude du comportement humain par rapport aux activités économiques, c’est aussi l’étude des lois régissant la structure monétaire, qui est la condition sine qua non de l’existence d’un système économique. » (Alvaro Cencini, (2007), Macroeconomic Foundations of Macroeconomics, Routledge, p. 278 et 280 (notre traduction))12.
Ainsi, en ce qui concerne la monnaie, le juriste et l’économiste devraient d’abord avoir une vision systémique13 ou macroéconomique de la réalité, c’est-à-dire, qu’en rapport avec la réalité, ils établiraient des concepts et découvriraient les relations logiques entre ces concepts indépendamment des comportements individuels ou collectifs des personnes concernées. Leur invalidation résulterait soit d’une mauvaise définition des concepts, soit d’une contradiction logique dans les relations.
« L’expérimentation ne peut ni confirmer ni infirmer une loi de la logique. Si l’expérience est contraire à la loi, celle-ci est mal déduite, et son imperfection ne résulte pas de sa confrontation aux faits : elle est interne. Au contraire, si la loi est parfaitement déduite, la réalité ne peut que s’y conformer. » (Bernard Schmitt, (1975), Théorie unitaire de la monnaie, nationale et internationale, Castella, p. 62)14.
La monnaie, en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment de sa forme physique, est une pure création humaine15. Mais, contrairement à ce qui est présenté par les juristes et les économistes du courant dominant, l’origine de la monnaie ne peut être que le paiement de la rémunération monétaire du travail humain pour former le revenu monétaire.
Le non-respect de ce principe provoque des dysfonctionnements réels. Les actions humaines à exécuter pour éviter ces dysfonctionnements pourraient être imposées par des lois normatives du législateur.
L’existence du travail rémunéré en monnaie, activité participant au bien-être de tous, nécessite qu’il soit pris soin de la nature et des travailleurs eux-mêmes et pas seulement du capital financier. La préservation tant de la nature que des travailleurs est nécessaire pour maintenir en vie le système, mais les actions de préservation ne constituent pas une réponse qui restructure le système. Cette réponse est comportementale ou microéconomique et pluridisciplinaire, car elle fait intervenir les comportements individuels ou collectifs des personnes concernées, avec les rapports de force en présence, dans un milieu pluriel. Les choix fait à partir de cette situation sont du domaine des lois normatives à voter par le législateur.
Enfin, selon Dennis Meadows16, ce ne sont pas seulement nos idées qui posent problème, ce sont aussi nos habitudes. Certes, elles nous font gagner du temps : on n’a plus à réfléchir à comment faire. Mais, certaines de nos habitudes économiques et politiques ont créé des problèmes (cf. pollutions, changements climatiques, extinctions d’espèces, …). Solutionner ces problèmes rend le changement de nos habitudes nécessaires. Même si au début, changer nos habitudes n’est pas très facile, ni très agréable, cela est possible. De plus, nous devons résoudre des problèmes complexes et maîtriser un nouveau type de réponse : les réponses adaptatives, lesquelles rendent réellement meilleur le système touché par le problème, plutôt que les réponses adictives, qui nous font seulement ressentir la situation meilleure sans résoudre le problème et en demandant de plus en plus d’actions alors que pendant ce temps la situation s’aggrave. Il demeure qu’agir est primordial.
Pour aller plus loin
- Cencini, Alvaro, (2007), Macroeconomic Foundations of Macroeconomics, Routledge, 358 p.
- Cencini, Alvaro, (2012), « L’origine de l’inflation, de la déflation et du chômage et leur solution par une réforme comptable des banques », The Quantum Analysis of Economics
- De Gottardi, Curzio, (1997), « Formation et dépense des revenus : analyse et comptabilité », Working paper, Université de Fribourg
- De Gottardi, Curzio, (2000), Offre et demande : équilibre ou identité ?, Thèse, Université de Fribourg, p. 2-15
- Sadigh, Elie, avec la collaboration de Rémond, Régis, (2006), Méthodologies économiques et éthique scientifique, L’Harmattan, 250 p.
- Schmitt, Bernard, (1984), Inflation, chômage et malformation du capital, Castella, 589 p.
- The Quantum Analysis of Economics
- Virely, Simon, (2013), « La science économique : normes ou lois ? », in Science Humaines Combinées, Revue électronique des écoles doctorales ED LISIT et ED LETS n° 11
- Méthodologie en science sociale et Textes de méthodologie des sciences humaines, Les classiques des sciences sociales, Université du Québec à Chicoutimi
- Donella Meadows, (2022) Pour une pensée systémique, Rue de l’échiquier, 288 p.
- Chavagneux, Christian, (2007), « L’économie, science ou idéologie ? », Le blog de Christian Chavagneux, Alternatives économiques
- Cozic, Mikaël, (2014), « La méthodologie économique du déductivisme millien au néo-positivisme », in Revue d’économie politique, vol. 124, p. 23-73
- Diewaide, Patrick, et Motamet-Nejad, Ramine, (1994), « Méthodologie et hétérodoxie en économie : retours sur Henri Lefebvre », in Espaces et sociétés, n° 76, p. 69-98
- Hoppe, Hans-Herman, (2019), Science économique et méthodologie autrichienne, Traduction par Stéphane Geyres, Institut Coppet, 87 p.
- Jensen, Pablo, (2018), Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations, Seuil, 336 p.
- Malbranque, Benoît, (2014), Introduction à la méthodologie économique, Institut Coppet, 135 p.
- Mouchot, Claude, (2000), « De quelques analogies physiques en économie politique », in Revue européenne des sciences sociales, XXXVI-117, p. 121-130
- Mouchot, Claude, (2018), « La théorie néoclassique : image fausse et immorale de la société »
- Mouchot, Claude, « Une véritable épistémologie de l’économie »
- Reinesh, Gaston, (2022), Essai d’économie politique, 4589 p.
- Sapir, Jacques, (2015), Les Trous noirs de la science économique, Albin Michel, 328 p.
- Serra, Daniel, (2012), « Principes méthodologiques et pratiques de l’économie expérimentale : une vue d’ensemble », in Revue de philosophie économique, vol. 13, p. 21-78
- Collectif, La théorie économique est-elle utile ?, Cahiers d’économie politique, n° 77, 2020/1
- Synthèse d’économie politique, à partir du livre de G. Maniw et des notes de cours, docnotes, 2012, p. 3-11
- « Paranormale économie », épisode 3 : L’économie est-elle une science occulte ?, Entendez-vous l’éco, Thiphaine de Rocquigny, France culture, 21/12/2022 (fichier son 58 min.) et les documents cités pour aller plus loin :
- de Curraize, Yves, & Thoron, Sylvie, (2020), « À propos du statut épistémologique des expériences en économie », in Revue d’économie politique, Vol. 130, Dalloz, p. 545-572
- Favreau, Judith, (2021), Le hasard de la preuve, Apports et limites de l’économie expérimentale du développement, ENS éditions, 292 p.875
* Tout en demeurant seul responsable de cet article, je remercie les professeurs Alvaro Cencini et Jacques Viléo, chacun pour son observation sur sa version initiale.
1 Gregory Bateson, (1972, 1980), Vers une écologie de l’esprit, Seuil, tome 2, p. 260, cité par Silvain Piron in Sylvain Piron, (2018), L’occupation du monde, Zones Sensibles, p. 55 et note 12, comme suit : « Notre tâche la plus urgente est d’apprendre à penser autrement. ».
2 Gaston Bachelard, (1938, 2011), La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Librairie Philosophique J. Vrin, p. 13.
2bis John Maynard Keynes, Essais de persuasion, NRF-Librairie Gallimard, Paris, 1933, p. 243-244, cité par Olivier Briffaut in Capital et monnaie. L’économie pathologique, éditions Le Manuscrit, Paris, 2003, p. 492.
3 Cf. notamment :
- La définition d’un comptable Pierre Garnier, (1947), La comptabilité : algèbre du droit et méthode d’observation des sciences économiques, Dunod, 126 p. « Pierre Garnier considérait que la comptabilité était une technique d’observation (ou plutôt de modélisation car il n’y a pas d’observation pure et toute observation obéit au moins implicitement à un cadre cognitif qui l’oriente et la structure) des organisations soumises à des contraintes juridiques fortes, à un droit qui n’était autre que le droit civil. […] Sa dépendance à l’égard du droit civil, ancienne et soulignée par Pierre Garnier, se fait à travers la notion de patrimoine » (Bernard Colasse, (2004), « L’évolution récente du droit comptable », L’actualité comptable 2004, conférence organisée par l’Association Française de Comptabilité à l’ENS de Cachan, France). L’Académie française donne au mot algèbre la définition suivante : « Branche des mathématiques dans laquelle, les grandeurs et les nombres étant représentés par des lettres, les problèmes sont résolus par des formules » (source : Dictionnaire de l’Académie française).
- Ce qu’écrit l’économiste Jean-Luc Bailly sur l’origine de la comptabilité en partie double. « D’un point de vue économique,la production occasionne une dépense avec effet positif, puisqu’elle fait naître un produit, alors que la consommation est une recette avec effet négatif, qui détruit les produits utiles en les convertissant en valeur d’usage. L’objet créé est le même que l’objet consommé, donc la dépense positive est rigoureusement égale, nous pouvons même dire, à strictement parler, identique à la dépense négative. ». Cette dernière phrase est suivie de la note suivante : « C’est de la prise en compte de cette identité que découle la comptabilité en partie double, et non l’inverse comme le prétendent certains auteurs. Ce n’est pas la comptabilité qui fait les identités. La comptabilité en partie double, dont on trouve des traces 3000 ans avant J.C., n’est pas une pure invention des hommes, elle est une découverte de ce qui structure l’activité économique. » (Jean-Luc Bailly, (2024), Revenu, travail et monnaie. De la genèse du capitalisme, L’Harmattan, p. 45-46).
- La force probante de la comptabilité (article L123-23, al. 1 du Code de commerce français ; article 8.11, § 2 du Code civil belge) par rapport à celle des copies (article 1379 du Code civil français ; articles 8.25 et 8.26 du Code civil belge)
- L’établissement de normes comptables à partir du droit, dont : le règlement N° 2020-05 du 24/07/2020 de l’Autorité des normes comptables modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au plan comptable général + (Version recueil) ; l’avis du 20/10/2021 de la Commission des normes comptables : Avis CNC 2021/6 – Évaluation et comptabilisation des cryptomonnaies utilisées comme moyen de paiement
- L’article de la juriste Marie-Anne Frison-Roche, (2011), « L’ancrage de la comptabilité dans le droit civil et ses conséquences dans les concepts sous-jacents des normes comptables », in La comptabilité est-elle un film ou une photo ?, 2e États généraux de la recherche comptable, Paris
- Pour le juriste Remy Libchaber, « le droit comptable utilise la monnaie comme moyen de contrôle, sans pour autant s’intéresser à sa nature et aux relations juridiques qu’elle implique ». Cependant, « aucune théorie monétaire ne peut se passer d’une théorie de la valeur, sauf à demeurer incomplète. Les économistes s’y sont essayés depuis longtemps ; les juristes point encore. Il est vrai qu’il n’est pas certain que la valeur soit encore dans le domaine juridique. » (Remy Libchaber, (1992), Recherches sur la monnaie en droit privé, LGDJ, respectivement p. 9, note 1 et p. 27, note 2)
4 Au sujet de l’économie, Marcel Gauchet parle d’un mensonge d’un type particulier parce que c’est un « mensonge qui conditionne une action concrète selon le mensonge » (« Autour de Marcel Gauchet : le nouveau monde – 1ère partie », EHESS, CanalU, 06/10/2017, à partir de 1:00:38). Ce propos est bien illustré par la bande-dessinée du tweet du 12/01/2023 de Thiphaine de Rocquigny, dont la traduction du dialogue suit : Dame (D) : « Y-a-t-il un docteur ici ? » ; Homme (H) : « Je suis docteur » ; D : « Il fait une crise cardiaque » ; H : « Je suis docteur en économie » ; D : « Il va mourir » ; H : « Impossible. Ce ne serait pas dans son intérêt ».
5 Cf. Déclaration de Philadelphie, article I, (a) ; Alain Supiot, (2019), Le travail n’est pas une marchandises. Contenu et sens du travail au XXIe siècle, Collège de France, 72 p et Vincent Vernay, (2011), « Le travail est-il une marchandise ? Économie d’échanges réels versus économie monétaire de production », in Repenser le travail et ses régulations, Presses universitaires François Rabelais, p. 125-136..
6 Cf. Nicolas Piluso, (2020), « Le salariat n’est pas un rapport d’échange : l’influence de la théorie de Schmitt sur celle de Jean Cartelier », Cahiers d’Économie Politique, n° 78, L’Harmattan, p. 143-171
7 Sylvain Piron, (2018), L’occupation du monde, Zones Sensibles, 237 p. et Sylvain Piron, (2020), Généalogie de la morale économique, Zones sensibles, 446 p.
8 « Si vous placez Dieu à l’extérieur, si vous le campez face à sa création, et si vous pensez avoir été créé à son image, vous vous considérez alors, logiquement et naturellement, comme extérieur et opposé aux choses qui vous entourent. Et, comme vous vous arrogez tout esprit, vous penserez alors que le monde qui vous entoure en est dépourvu et par conséquent qu’il ne peut prétendre à aucune considération morale ou éthique. L’environnement semblera vous appartenir et être voué à l’exploitation. Votre unité de survie se composera de vous-même, de vos proches et des membres de votre espèce, contre l’environnement d’autres unités sociales et d’autres races, contre les bêtes et les végétaux. Si c’est ainsi que vous concevez votre relation à la nature, et si vous disposez d’une technologie avancée, alors vos chances de survie seront celles d’une boule de neige en enfer : vous succomberez aux sous-produits toxiques de votre haine, ou plus simplement, à la surpopulation et au surpâturage. » (Gregory Bateson, (1972, 1980), op. cit., p. 259 (traduction revue par Grégory Delaplace) cité par Sylvain Piron in Sylvain Piron, (2018), op. cit., p. 55 et note 11)
8bis Christian De Brie, « La condition inhumaine », Le Monde Diplomatique, mars 2025, p. 23
9 Sylvain Piron, (2018), op. cit., p. 55
10 7 Cf. Osamu Nishitani, (2022), L’impérialisme de la liberté, Un autre regard sur l’Amérique, Seuil, 336 p.
11 Cf. « Baptiste Morizot, sur la piste du vivant », Profession philosophe, Adèle Van Reeth, France culture, 02/10/2020, à partir de 11 min. 33 sec.
12 Contra, la vision réductrice de Jean Hilgers, alors directeur de la Banque nationale de Belgique et économiste : « L’économie, c’est une science humaine, c’est la science des comportements humains, mais ce n’est pas une science exacte. C’est une des raisons pour lesquelles les économistes ne sont pas toujours d’accord entre eux, comme dans d’autres disciplines. » (Audition de M. Hilgers, Président du groupe d’experts chargés d’étudier la dette de la Wallonie, Compte rendu intégral de la séance publique de la Commission du budget et des infrastructures sportives, Parlement wallon, n° 52, session 2021-2022, 08/11/2021, p. 10)
13 Donella Meadows définit un système comme un « ensemble d’éléments ou de parties organisés et reliés entre eux selon une configuration ou structure qui génèrent un ensemble cohérent de comportements, souvent envisagés comme la « fonction » ou l’ »objectif » du système. » (Donella Meadows, (2022), Pour une pensée systémique, Rue de l’échiquier, p. 33 et 249).
14 Un exemple : « La logique ne dit pas qu’aucune monnaie nationale ne peut circuler dans les relations internationales mais seulement que toute monnaie nationale qui circule ainsi est une fausse monnaie [c’est-à-dire qu’elle n’a pas le pouvoir d’éteindre la dette du débiteur qui paie avec cette monnaie ; le pouvoir libératoire n’est pas entendu en son seul sens juridique, mais plus fondamentalement en logique : « Nul ne paie avec sa propre dette »]. Les faits ne peuvent ni infirmer ni confirmer cette conclusion, qui est entièrement le résultat du principe de non-contradiction. » (Bernard Schmitt, (1977), op.cit., p. 115 et 20 à 27)
15 Cf. « Le crédit et la monnaie sont des institutions humaines. Comme toutes les institutions humaines, elles peuvent être conçues de manières différentes. » (Charles Rist, Histoire des doctrines relatives au crédit et à la monnaie depuis John Law jusqu’à nos jours, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1938, p. 2) ; « Qui crée la monnaie ? », ABC de l’économie, Banque de France, 22/02/2019. De plus, remarquez que, d’une part, l’unité monétaire est observable : elle n’est pas construite par l’économiste, qui observe, contrairement aux grandeurs de la physique que le physicien crée (cf. Jacques Cartelier, (2023), « La monnaie comme enjeu de philosophie sociale », § 3, p. 1), et que, d’autre part, « les revenus ne préexistent pas dans la société » (Vincent Soyer, (2018), L’économie de production monétaire, p. 118).
16 Cf. BEYOND THE LIMITS TO GROWTH, Conférence de Dennis Meadows à l’École Normale Supérieure de Lyon, 19/09/2022 (vidéo 28 min avec sous-titrage en français)