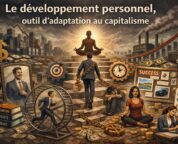Wangari Maathai, Celle qui plantait des arbres. Autobiographie, traduit de l’anglais par Isabelle Taudière, Edition Héloïse d’Ormesson, 2007, 432 p.
De sa mère, Wangari (1940-2011) a appris l’art de cultiver la terre. Par son père, qui travaillait dans le domaine d’un colon anglais, elle a vite compris l’injustice du colonialisme.
« L’instruction, passeport pour l’avenir »
Grâce au soutien familial et à des bourses, elle a la chance d’aller à l’école, et même d’étudier aux États-Unis, où elle obtient une licence en biologie, chimie et allemand, puis une maîtrise en embryologie et micro-anatomie.
Conscience sociale et environnementale
Aux USA comme au Kenya, elle vit la ségrégation et constate les dégâts de la pollution. Ainsi elle observe la déforestation galopante, qui entraîne l’érosion des sols et leur appauvrissement, ce qui affame le bétail et la population et crée une association de paysannes. Pour contrer le conservatisme de la bourgeoisie kényane, elle organise un événement médiatique : lors de la journée mondiale de l’environnement, elle plante des arbres dans un lieu symbolique avec l’aide de personnalités politiques. C’est la première ceinture verte. Des formations à la sylviculture sont organisées et chaque plant qui a pris donne droit à une prime. Elle accepte une mission des Nations Unies pour le développement : le mouvement de la ceinture verte est connu au Kenya et à l’étranger. Elle donne des séminaires de sensibilisation civique et environnementale pour les villageois. Y sont abordés des thèmes comme la démocratie, les droits de l’homme, l’égalité des sexes et le pouvoir. La composante culturelle et non mercantile est importante et permet de se rattacher à la valeur d’un arbre dans leur culture traditionnelle. En 1985, 30 millions d’arbres avaient été plantés. Autre action couronnée de succès, grâce à une campagne de longue haleine largement soutenue à travers le pays, elle empêche la construction d’une tour au milieu d’un parc à Nairobi.
Combat féministe
Dès son retour au Kenya, elle se heurte aux préjugés sexistes puisque le poste qui lui était promis va à un homme. Sexisme encore lorsque son mari la quitte en l’accusant d’être trop instruite et difficile à contrôler. Wangari devient présidente du Conseil national des femmes du Kenya.
Combat pour les droits humains. Le Kenya des années 90 est un pays totalitaire. Les élections sont truquées, la corruption est omniprésente et l’indépendance de la justice très réduite. La répression s’intensifie. Wangari se sent en danger. Lors d’un rassemblement démocratique, la police tire et fait plusieurs dizaines de morts. Le mouvement de la ceinture verte plante des arbres en leur mémoire. Wangari se barricade chez elle, mais des policiers l’en sortent de force et elle est enfermée dans un cachot sordide, ce qui contraste avec deux précédentes incarcérations, où elle avait fait l’expérience de la solidarité de ses codétenues et même des gardiennes. Épuisée et souffrant des genoux, elle n’arrive plus à marcher pour se rendre au tribunal. Libérée sous caution, elle sort du tribunal sur une civière.
Des mères créent une association » Libérez les prisonniers politiques » avec son soutien. Elles se rendent chez le procureur général pour exiger la libération de leurs enfants et de tous les prisonniers politiques. Malgré la brutalité de la répression, elles ne repartent, un an plus tard qu’accompagnées de leur fils et un « diplôme de résistante » dans l’autre main.
Wangari s’investit pour l’opposition démocratique et dénonce les violences inter-ethniques.
En 2000 Wangari s’engage pour l’annulation de la dette des pays pauvres ; elle est une nouvelle fois arrêtée mais les associations internationales font plier le gouvernement et elle est innocentée.
En 2002 Wangari est élue au parlement. En 2004 Wangari reçoit le prix Nobel de la paix. C’est le couronnement d’une vie de travail acharné et de persévérance.