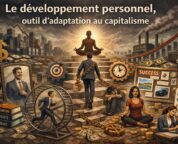Cette analyse retrace l’histoire de l’alimentation humaine afin de comprendre l’origine des inégalités actuelles face à la nourriture. Elle met en lumière le paradoxe contemporain : alors qu’une part croissante de la population mondiale souffre de surpoids ou d’obésité, la faim et la malnutrition touchent encore des centaines de millions de personnes. Cette situation est le résultat d’une longue évolution : des chasseurs-cueilleurs omnivores, adaptables mais soumis à l’aléa alimentaire, l’humanité est passée à la sédentarisation, à l’agriculture et à l’élevage, une transition qui a entraîné une diversification des régimes alimentaires mais aussi l’apparition de carences, de famines et d’inégalités. L’histoire montre que l’accès à la nourriture, sa diversité et sa qualité ont toujours été au cœur des enjeux sociaux, économiques et sanitaires.
Le texte explore aussi l’aspect anthropologique de l’alimentation, notamment à travers le principe d’incorporation : « nous sommes ce que nous mangeons ». Ce principe, à la fois biologique, culturel et symbolique, influence les choix alimentaires, les tabous, les identités individuelles et collectives. Il est renforcé par d’autres lois, comme celle de contagion (la peur de la contamination) et de similitude (l’apparence d’un aliment influence sa consommation). L’acte de manger dépasse donc la simple satisfaction d’un besoin vital : il façonne notre rapport au corps, à la santé, à la société et à l’environnement. Dans un monde où l’industrialisation de l’alimentation brouille la connaissance des produits consommés, se pose la question fondamentale : si nous ne savons plus ce que nous mangeons, comment pouvons-nous savoir qui nous sommes et ce que nous deviendrons ?
Télécharger le PDF