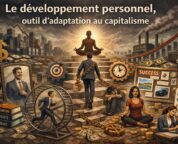Cette analyse souligne la nécessité de redécouvrir les méthodes de terrain et les outils traditionnels pour comprendre et gérer les milieux naturels. Elle met en avant l’importance des synthèses iconiques, telles que les dessins, les cartes topographiques et les profils écologiques, qui rendent accessibles des connaissances complexes sur la botanique, la zoologie ou la géographie. L’autrice regrette que l’usage des photos aériennes ait supplanté les cartes topographiques, car ces dernières permettaient de visualiser le relief, la couverture végétale et l’hydrographie, éléments essentiels pour saisir la dynamique des territoires. Cette évolution, couplée à la fragmentation administrative et à la perte des savoirs partagés, affaiblit la capacité collective à agir face aux enjeux écologiques et climatiques. L’exemple du bois de la Tannerie à Waremme illustre comment des décisions d’urbanisme prises sur la base de vues aériennes peuvent ignorer la complexité du terrain et menacer la biodiversité locale.
Le texte insiste également sur la perte d’un langage commun et d’une organisation administrative de proximité, autrefois incarnée par le Ministère de l’Agriculture, Eaux et Forêts, qui garantissait une gestion fine et actualisée des territoires grâce à un réseau dense d’acteurs de terrain. Aujourd’hui, la réorganisation en ministères plus vastes et spécialisés, le morcellement des responsabilités et la disparition des services publics locaux conduisent à une gestion défaillante des écosystèmes et à une inaction face aux défis du changement climatique. L’auteur appelle à une réappropriation collective des outils de compréhension du vivant et à une mobilisation pour des projets territoriaux ambitieux, en s’appuyant sur l’expertise locale et la connaissance fine des milieux naturels. Il plaide pour une meilleure prise en compte de la couverture végétale, de la biodiversité et des pratiques de terrain dans les politiques publiques, afin de restaurer la capacité d’agir collectivement pour la résilience écologique.